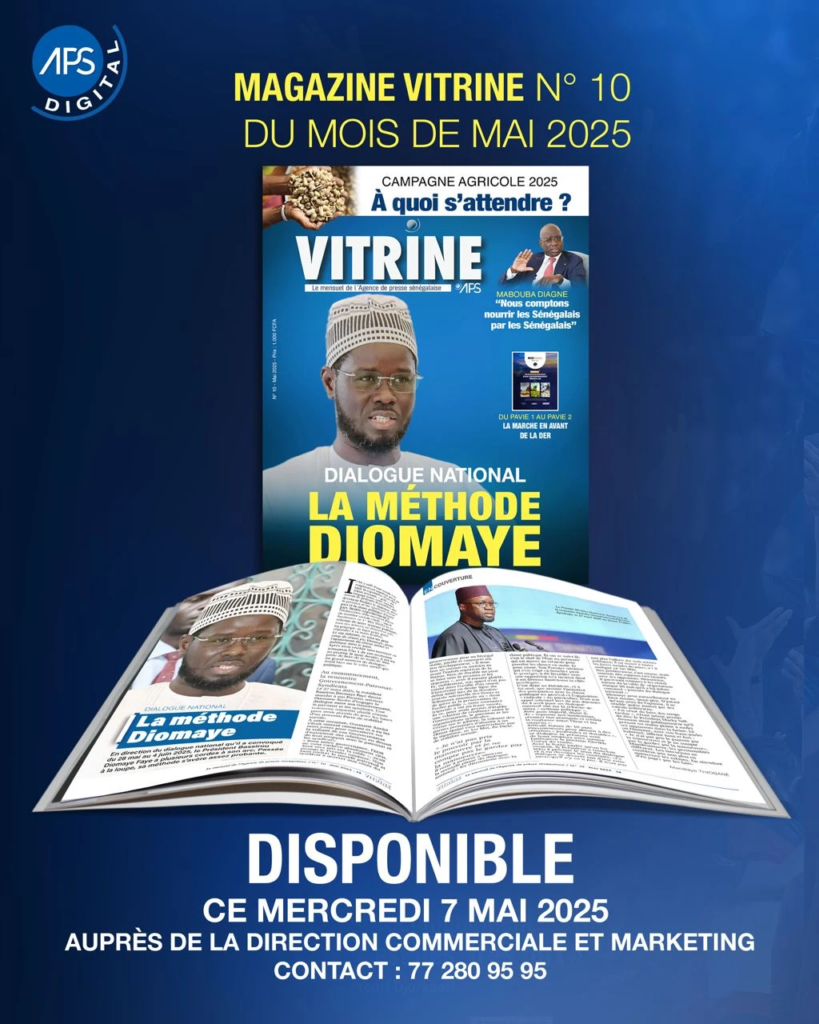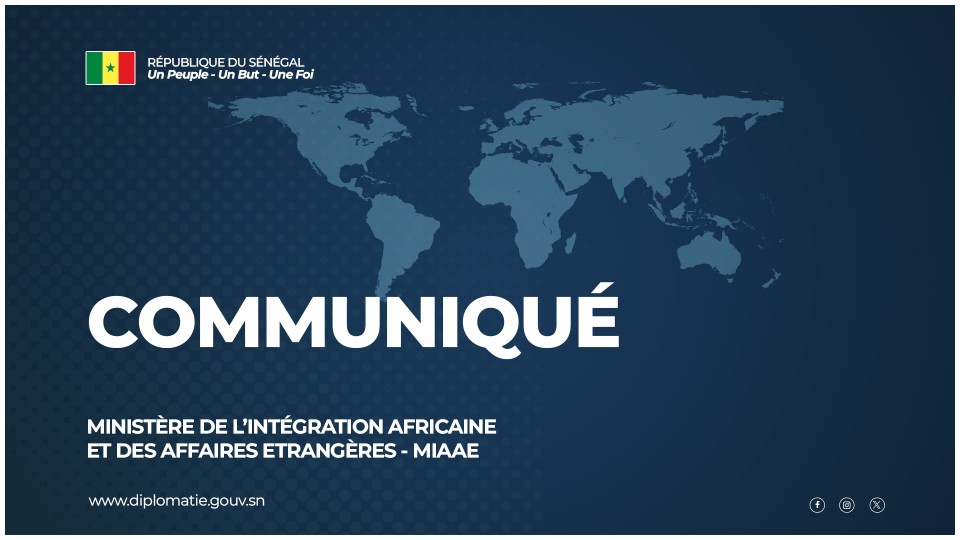SENEGAL-GENRE
Matam, 23 juin (APS) – La région de Matam est la zone la plus touchée par la pratique de l’excision pour la tranche d’âge 0-14 ans avec un taux 67%, loin devant la moyenne nationale de 12%, a-t-on appris, lundi, Lydie Sanka Kabou, la chargée du programme Genre, Violences basées sur le genre (VBG) et Droits humains du du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) au Sénégal.
‘’Selon les dernières données datant de 2023, Matam est la région la plus touchée en termes de prévalence de l’excision avec un taux de 67%, alors que le taux est de 12% au niveau national”, a-t-elle indiqué, précisant que la localité ‘’est fortement marquée’’ par cette pratique pourtant interdite depuis 1999.
La chargée de programme à l’UNFPA s’exprimait au cours d’un atelier de partage des outils sur le suivi communautaire des progrès sur les mutilations génitales féminines (MGF).
La rencontre, dont l’objectif de mesurer les changements constatés dans la lutte contre l’excision et des mariages précoces, a vu la participation de plusieurs acteurs venus des sept régions du Sénégal les plus touchées par ces pratiques.
‘’Cet atelier nous permettra de disposer d’outils afin de mieux comprendre la dynamique de changement, car l’excision est une pratique qui repose sur des normes sociales. Les données statistiques ne peuvent pas souvent démontrer réellement le changement qui est en train de s’opérer’’, a expliqué Lydie Sanka Kabou.

C’est pourquoi une autre formule, notamment le programme conjoint UNFPA-UNICEF, sera expérimentée afin de mesurer les changements observés, a-t-elle annoncé, précisant que ce sera une manière pour les structures s’activant dans la lutte contre les VBG de ‘’bien vendre leurs réalisations’’.
Ayant constaté que personne n’osait parler de lutte contre l’excision dans la région de Matam, il y a quelques années, elle se réjouit que cette pratique soit discutée aujourd’hui en vue, avec la tenue d’activités allant dans le sens de son éradication.
‘’Il s’agit là d’un changement qui doit être documenté et mesuré”, a-t-elle souligné, exprimant dans le même temps sa satisfaction de voir l’implication des filles leaders dans cette lutte, mais aussi des pairs éducateurs et d’ONG travaillant dans la région.
‘’Ce sont des changements non négligeables qui contribuent à l’abandon de ces pratiques”, a ajouté Lydie Sanka Kabou.
AT/HB/ASB/ABB